 |
Les grandes orgues
|
 accueil accueil
 photos photos
 concerts concerts l'Association l'Association Relevage Relevage orgues
en Dauphiné orgues
en Dauphiné  contact contact
|
 |
Les grandes orgues
|
 accueil accueil
 photos photos
 concerts concerts l'Association l'Association Relevage Relevage orgues
en Dauphiné orgues
en Dauphiné  contact contact
|
Par Bruno Charnay, titulaire.
Après avoir tenté de retracer l'évolution de l'orgue de Saint-André jusqu'au XIX° siècle, il me semble à propos de rassembler ici les principales informations dont nous disposons sur les autres orgues de Grenoble à partir des quelques archives qui ont été publiées. Peut-être d'autres documents dorment-il encore ici ou là, ce qui permettra de compléter - ou d'infirmer - l'histoire que j'essaye de reconstituer ici. Ceci va nous amener à évoquer les anciens lieux de culte de Grenoble, où les chapelles de couvents, rarement parvenues jusqu'à nous, étaient bien plus nombreuses et richement dotées que les églises paroissiales. Celles-là étaient d'ailleurs parfois plus fréquentées que celles-ci, au grand dam de l’évêque et des curés. Enfin, on verra nettement se dégager l'importance de deux instruments : celui de la cathédrale Notre-Dame et celui de la collégiale Saint-André.
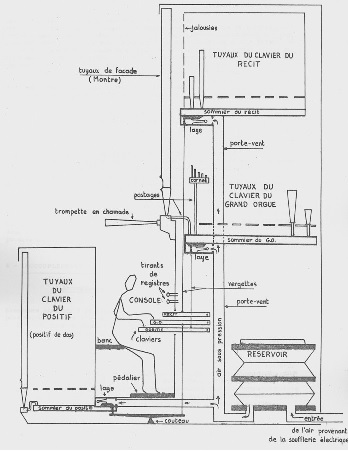 |
J'emploie moins de termes propres à
la facture d'orgue dans
ce document que dans le précédent. Cependant, on ne peut
totalement les éviter
et il y en a quelques-uns, assez récurrents, dont je voudrais
donner ici le
sens exact : Quand on parle de Grand-Orgue, ou de Grand Clavier, il s'agit du clavier principal de l'orgue, contenu dans ce qu'on appelle le grand buffet ou grand corps, par opposition au Positif, qui désigne à la fois le clavier secondaire de l'orgue et le meuble placé en bord de tribune et qui contient les tuyaux dudit clavier. Les claviers - ainsi que le pédalier et les tirages de jeux - sont placés dans un renfoncement du soubassement du grand buffet, pouvant ainsi directement actionner la mécanique de la plus grande partie de l'instrument. On parle de "console en fenêtre", mais on pourrait tout aussi bien parler de "console en placard", l'organiste ayant la tête dans le soubassement de l'instrument, à quelques dizaines de centimètres de la mécanique de l'instrument et ne voyant à peu près rien de ce qui l'entoure. Plus la mécanique est courte, plus l'organiste ressent le déclenchement de la soupape et peut lui donner vie. La mécanique du Positif, quant à elle, passe sous le siège de l'organiste pour rejoindre le buffet correspondant s'il existe. C'est pourquoi on parle de Positif de dos, puisqu'il se trouve dans le dos de l'organiste... mais plus près des yeux et des oreilles de l'auditeur. Il y a cependant des cas assez exceptionnels que j'aurai à évoquer où la tuyauterie du Positif est située dans le grand corps, qui est alors le seul buffet de l'orgue. Le grand buffet contient aussi la tuyauterie des claviers de Récit et d'Echo, s'il y a lieu, et celle du pédalier. Ce dernier reste peu développé jusqu'au début du XIX° siècle, sauf dans les pays germaniques, qui ont aussi par ailleurs pratiqué des mécaniques complexes permettant à l'organiste de jouer tourné vers l'autel et non vers le ventre de l'instrument. Cela permet surtout d'être au contact direct des chanteurs et instrumentistes qui concertent avec lui. Quant au "grand orgue", avec son équivalent emphatique bien connu "grandes orgues", qui désigne l'instrument principal d'une église et qui s'oppose ordinairement à "orgue de chœur", nous aurons peu à l'employer, dans la mesure où jusque vers 1850, il n'y a ordinairement qu'un orgue dans nos églises de France, le plain-chant étant généralement chanté a cappella, ou alors doublé par cet instrument au son quelque peu dinosaurien que l'on appelait le "serpent". Quand on veut mêler un orgue à un ensemble de musiciens, on emploie plutôt un petit orgue à un clavier qui est posé au sol et que l'on peut déplacer facilement, d'où son nom de "positif", alors que l'orgue de tribune est, pour employer une expression juridique, "immeuble par destination", dans la mesure où il n'est pas possible de le déplacer d'un centimètre au gré de sa fantaisie. On voit cependant la ressemblance de ce type de petit orgue avec le buffet de positif d'un grand-orgue, à la différence près que ce dernier est solidaire du reste de l'instrument. |
Comme dans le texte précédent, les
principaux ouvrages que
j'ai consultés (et que je recommande à qui voudrait aller
plus loin) sont
l'Inventaire national des orgues, publiés en volumes ou en
fichier
(généralement un par département) dans les deux
dernières décennies du XX°
siècle.
Nous l'avons vu, la présence d'un orgue est
attestée au
début du XV° siècle à la cathédrale,
à Saint-André et à l'église des
Dominicains. Notons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'églises
paroissiales :
à l'époque, les paroisses sont Saint-Hugues (attenante
à la cathédrale, mais
distincte), Saint-Jean (située place Saint-André, au
niveau de la statue de
Bayard actuelle) ainsi que Saint-Laurent pour le faubourg de la rive
droite de
l'Isère. Saint-Laurent est à la fois un prieuré
bénédictin et le siège d'une
paroisse avec curé et vicaire, et même un conseil de
fabrique institué par Mgr
Laurent Alleman à l'époque qui nous occupe. Bien que
paroisse et monastère
soient alors fort prospères, on n'a pas encore mis au jour de
documents
attestant l'existence d'un orgue à cette époque. En 1647,
il est fait mention
d'un organiste, puis en 1749, on achète un nouvel orgue (soit il
n'y en avait
plus, soit on a voulu en acheter un meilleur...)
Les couvents existant à l'époque
sont ceux des ordres
mendiants, Franciscains (ou Cordeliers) et Dominicains (ou Jacobins).
Comme on
sait que le couvent des Dominicains était
particulièrement florissant, rien
d'étonnant à ce qu'on y trouve un orgue. Les Cordeliers
en eurent un aussi,
mais peut-être à une époque plus tardive. Ils
avaient une place non négligeable
dans la vie de la cité, mais des péripéties comme
l'occupation de leur chapelle
par les Protestants dès 1562, puis plus encore leur nouvelle
installation sur
l'actuelle place de Bérulle en 1590, lorsque Lesdiguières
récupéra leur ancien
couvent pour y installer son arsenal, ont certainement fait passer le
souci des
orgues au second plan...
L'inventaire des orgues réalisé dans
la France entière à la
Révolution (dans le but d'en estimer la valeur pour les vendre
éventuellement...) fait état de six orgues
d'église (Inv. pp.21 et seq.) :
Ce dernier instrument avait été
transporté à l'hospice civil
"à la fin du siècle". Son buffet avait été
réalisé par Thomas Hache
en 1744. Précision intéressante, vu la
notoriété et le talent de l'artisan,
mais nous n'avons aucun détail sur la composition de cet orgue
car les deux
experts envoyés par le District n'ont pas été
autorisés à y accéder par les
administrateurs. On peut penser qu'il était de dimension
semblable aux deux
précédents.
Les quatre premiers nommés avaient
évidement un pédalier. On
peut le supposer pour les deux autres, même si ce pédalier
pouvait être en
tirasse, c'est à dire démuni de jeux propres mais muni
d'un mécanisme lui
permettant d'actionner les touches correspondantes dans le grave du
clavier.
Précisons qu'à cette époque,
dans l'orgue français type, le
dernier clavier (celui du haut) ne parle que sur la partie aiguë,
les deux
premières octaves étant fixes : c'est le clavier de
Récit ou d'Echo, destiné à
faire parler un jeu, parfois plus, auquel est juste dévolu une
partie mélodique.
De grands instruments possèdent ces deux demi-claviers en plus
du Grand Clavier
et du Positif, comme on l'a vu pour l'orgue (inachevé, de fait)
de Saint-André.
Deux remarques concernant les églises
paroissiales :
Deux remarques concernant les orgues de couvents :
Sur les six instruments mentionnés, on
constate que deux
seulement échapperont au vandalisme révolutionnaire :
ceux de la cathédrale et
de la collégiale, soit le tiers des orgues dont nous avons
connaissance. C'est
hélas assez représentatif des pertes
révolutionnaires en France. Enfin, ces
deux rescapés seront démolis et remplacés avant la
fin du XIX° siècle, le
manque d'entretien consécutif à l'interdiction du culte
pendant plusieurs
années et la grande misère des églises lorsque les
paroisses se relèvent au
début du XIX° siècle ayant entraîné des
dommages sans retour. Ils ne laissent
donc comme souvenir que leurs buffets, malheureusement tous deux assez
mutilés.
L'orgue de la cathédrale possédait
certaines particularités
qui rendent encore plus triste sa disparition. On les a souvent
citées, sans
toutefois y chercher une explication. C'est en effet un instrument bien
énigmatique sur plusieurs points. De plus, les archives sont
très rares, pour
ne pas dire inexistantes pour la période de sa construction.
Le buffet a été classé
Monument Historique en 1992, en tant
qu'œuvre de Jacques Mollard, auquel l'arrêté de
classement attribue aussi la
partie instrumentale sur la foi d'un courrier de 1699 dans lequel ce
facteur
d'orgue s'excuse de ne pouvoir s'occuper du jacquemard de Romans car il
travaillait "à l'achèvement des orgues de Notre-Dame".
Faut-il en
déduire pour autant qu'il avait construit cet instrument
à neuf ? Sans être
impossible, c'est quand même assez surprenant pour cet artisan
qu'on ne connait
que pour des travaux fort limités à Lyon, sur l'orgue du
monastère royal de
Saint-Pierre et peut-être sur celui des Célestins. Jacques
Mollard est quand
même davantage connu pour son activité d'horloger... et
d’huissier. N'oublions
pas que dès 1686, les chanoines de Saint-André avaient
fait
"franciser" leur orgue par un Lyonnais, justement, François
Dufayet,
tandis que les Ducs de Savoie possédaient dans leur
Sainte-Chapelle de Chambéry
un orgue de style français construit en 1675 par Etienne Senot,
ou Senault, de
Bourges (voir Inv. des orgues de Savoie). Imagine-t-on
l'évêque de Grenoble,
ancien chapelain de Louis XIV, le fameux cardinal Le Camus, dans le
diocèse
duquel se trouvait alors Chambéry, admettre la construction dans
sa cathédrale
d'un orgue si "démodé" en 1699 ? Cela me paraît
impensable... Voici
donc un indice de plus (parmi d'autres) pour penser que Jacques
Mollard, s'il a
bien "achevé" (i.e. agrandi et complété) l'orgue
de Notre-Dame, ne
l'a pas construit à neuf. Deux ans avant sa mort, il aurait
même pu être encore
l'auteur des travaux de 1715 mentionnés sans autre
précision sur le site de
l'Association des amis de l'orgue de la cathédrale de Grenoble.
Ayant travaillé à Lyon, il y a donc
vu des orgues édifiés
par des grands noms de la facture française. Il serait
surprenant qu'il
ait alors construit à Grenoble un instrument présentant
des particularités le
rattachant à une tradition transalpine. Ainsi le tirage de jeux
à l'italienne,
c'est-à-dire "ne se tirant point ni ne se poussant ; on les
déplace de
droite à gauche et vice versa". (Inv.p.301). Des facteurs
régionaux comme
les frères Eustache, de Gap, on pratiqué ce
système, mais beaucoup plus tôt
(vers 1660).
De la même façon, certaines
caractéristiques du buffet
semblent indiquer une époque voisine de 1660. Ainsi, les trois
grandes
tourelles assez aplaties, et surtout cette double rangée de
plates-faces
semblables, superposées les unes sur les autres (Inv.ibid.). On
ne trouve cette
disposition assez rare en France que dans des instruments de cette
époque et
tous dans le sud de la France. Ainsi, les orgues des cathédrales
de Toulouse
(1609), Marseille (Vieille Major, détruite, 1661), la
collégiale de Draguignan
(Eustache, 1638, aujourd'hui disparu). Parmi quelques autres, je ne
peux passer
sous silence ce buffet si extraordinaire de la cathédrale de
Saint-Bertrand-de-Comminges
(1550), qui est antérieur d'un siècle aux
précédents et par conséquent de style
Renaissance. Si on excepte sa forme en angle, absolument unique, due
à une
magnifique adaptation à son emplacement dans la
cathédrale, c'est celui dont
l'ordonnancement général ressemble le plus à celui
de Grenoble. Rapprochement
bien éloigné dans le temps, mais qui pourrait encore
témoigner du caractère
exemplaire de ce meuble unique.
Tous ces buffets ont trois grandes tourelles,
celle de
centre dépassant de peu les deux autres. Sauf le dernier, ils
répondent aussi à
la description faite par Cavaillé-Coll : "La construction
originaire de cet
orgue paraît remonter au siècle de Louis XIII. Le buffet
porte l'empreinte du
style architectonique de ce temps... Ce buffet se trouve
couronné par un grand
entablement en ligne droite..." Pour la partie instrumentale,
Cavaillé-Coll estime qu'elle "a tout au moins deux
siècles d'existence...
Les claviers à main... manquent du premier Ut # dans la basse...
Le clavier de
pédale ... dénote la plus ancienne origine". Voir Inv. p.
31 pour le texte
complet.
La pédale comportait un jeu de 16 pieds, ce
qui est fort
rare en France sous l'Ancien Régime, sauf en complément
d'une pédale déjà bien
fournie en jeux dans de grands instruments assez tardifs. Il faudrait
donc
plutôt y voir une influence italienne. D'autre part, le plus
grand tuyau de ce
jeu comportait l'inscription : "J. Gonard, 1660". Je serais fort
tenté d'y voir l'indice de la construction première de
cet orgue par un facteur
italien ayant francisé son nom, ou d'un facteur français
formé en Italie...
quitte à prendre à rebours l'arrêté de
classement de 1992. Evidemment, je ne
demande pas mieux que d'être contredit par des archives
nouvellement mises au jour.
Une autre particularité de cet instrument
est la présence de
trois claviers complets et un demi-clavier d'écho, alors que les
orgues
français de l'époque se contentaient de deux claviers
complets, plus un ou deux
demi-claviers (Récit ou/et Echo). Je ne vois guère que
l'exception magistrale
de l'orgue Isnard de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, par ailleurs bien plus tardif (1773). A
Grenoble, l'instrument d'origine avait peut-être la tuyauterie de
ses deux
claviers dans le même grand buffet, sans positif de dos, comme on
peut le voir
souvent au XVII° siècle, particulièrement dans le sud
de la France. Pour le
mettre "à la mode", on l'aurait ensuite doté d'un positif
de dos
construit selon la hauteur disponible, donc assez réduit par
rapport au grand
buffet, puis l'on aurait ajouté un clavier pour le faire parler,
sans trop
retoucher l'organisation intérieure de l'orgue
préexistant. Cela pourrait faire
penser à l'orgue de la cathédrale Saint-Nazaire de
Carcassonne : l'orgue du
XVII° avec ses deux claviers1/2 contenus dans un buffet unique a
été doté d'un
positif de dos entre 1772 et 1775, mais dans ce cas, on a réuni
sur un seul
clavier (travail plus complexe) la tuyauterie contenue dans le grand
buffet
(Grand clavier et positif primitif) et agrandi le grand buffet pour
loger de
nouveaux jeux de pédale.
Voici donc, pour les amateurs qui ne la
connaîtraient pas,
la composition étonnante de cet orgue grenoblois :
Je serais donc tenté d'imaginer la petite
histoire suivante,
dont l'esprit ne changerait pas fondamentalement si l'orgue avait
été
réellement construit à neuf par Jacques Mollard en 1699.
En ce cas cependant,
l'impulsion de départ aurait été donnée par
l'orgue de la collégiale, ce qui
serait aussi surprenant, les fonds disponibles freinant la
réalisation des
travaux ambitieux prévus au départ :
Cette petite histoire aux allures de course
à l'échalote est
d'autant plus plausible que l'on connaît la concurrence qui a
toujours existé
entre les deux chapitres de chanoines (Notre-Dame et
Saint-André), issue de la
lutte de pouvoir entre le Dauphin et l'Evêque, celui-ci cherchant
à affirmer
l'antériorité de son pouvoir temporel face aux
prétentions envahissantes de
celui-là. Selon l'éminent archéologue et historien
de l'art Alain de Montjoye,
on peut même très sérieusement penser que c'est la
construction de la
collégiale Saint-André par le Dauphin Guigues VI
André à partir de 1228 qui a
entraîné quelques années plus tard la
démolition de la cathédrale romane pour
construire l'édifice gothique que nous connaissons "entre le
milieu et le
troisième quart du XIII° siècle au plus tard" (cf.
Autour du groupe
épiscopal de Grenoble, ouvrage collectif, DARA, Lyon, 1998). Par
ailleurs,
comme on le sait, la hauteur des tours est un symbole de pouvoir. La
tour de la
cathédrale n'était pas très haute (un étage
de moins qu'aujourd'hui) et la tour
de l'Evêché la dépassait même
peut-être. Il est alors significatif que le
Dauphin ait fait édifier à Saint-André la fameuse
flèche que nous admirons
toujours, le plus haut monument de Grenoble jusqu'à...
l'édification du clocher
de Saint-Bruno en 1879... en attendant la tour Perret, mais cela est
encore une
autre histoire.
Après le massacre de l'intérieur de
la cathédrale par
l'architecte diocésain Alfred Berruyer, sous prétexte
d'embellissement, il n'y
a donc plus ni grande tribune ouest, ni grand-orgue en 1862. Le buffet
ancien,
après avoir été charcuté et
rafistolé par le facteur Goll, dont on a déjà
parlé, est quasiment plaqué au mur du clocher sur une
espèce de balcon, comme
on peut le voir encore aujourd'hui. Le facteur le plus
célèbre (et génial) de
France, Aristide Cavaillé-Coll, à qui
l'Evêché avait fait rédiger depuis 1859
des projets d'orgues de plus en plus petits, place finalement en 1863
derrière
ce buffet, sous l'arcade du clocher, un orgue de... huit jeux,
aujourd'hui à
l'église paroissiale de Voreppe (voir l'Inv. pour cette autre
histoire d'orgue
nomade).
En 1898, le facteur Anneessens construit à
la collégiale un
orgue entièrement neuf de 32 registres, celui que nous pouvons
toujours
entendre aujourd'hui après restaurations et agrandissements
successifs. Le même
facteur construit encore l'orgue de la nouvelle église
Saint-Bruno à laquelle
nous faisions allusion précédemment, puis l'orgue du
Petit Séminaire de la
Côte-Saint-André en 1902. Et voilà un
troisième orgue voyageur, puisqu'il va
être transféré à la cathédrale et
remonté par le Lyonnais Ruche en 1931. Trois
instruments donc dus au même facteur belge à Grenoble dans
les trois églises
principales de la ville, si on excepte Saint-Louis, où l'orgue
en provenance de
Saint-Antoine a été reconstruit en 1902 par le facteur,
suisse cette fois,
Théodore Kuhn.
Et les autres églises ? Saint-Laurent, qui
n'avait plus
d'orgue après la Révolution, comme on l'a vu, est
dotée d'un nouvel instrument
au XIX° siècle. Il est aujourd'hui à la
cathédrale, où il sert d'orgue de
choeur, et même d'orgue unique, depuis que les travaux
d'architecture dans le
clocher ont rendu le grand-orgue muet en 1990... Deux autres
instruments,
construits vers 1850, n'ont pas bien franchi les limites du
siècle : celui de
Saint-Joseph, dont on ne connaît qu'une photo du buffet
(évoquant les
Callinet), ne fonctionnait plus en 1900. Malgré un projet de
transfert dans la
nouvelle église demandé au facteur (suisse encore)
Tschanum, il a disparu à la
démolition de l'ancienne en 1929. Il a fallu attendre 1943 pour
que cette
nouvelle église (devenue basilique) fût enfin dotée
d'un orgue. Quant à celui
de la chapelle de l'Ecole professionnelle de Vaucanson, construit par
le
facteur grenoblois Frédéric Mayer, il a été
vendu avant la fin du siècle et se
trouve aujourd'hui à l'église paroissiale de
Virieu-sur-Bourbre (orgue classé
Monuments Historiques). Cela nous permet de citer encore deux orgues
qui ont
peut-être moins voyagé que les trois premiers, mais qui
n'ont pas souffert
quand même de sédentarité.
Rappelons aussi la construction d'un orgue au
nouveau temple
de la rue Hébert par le facteur Goll en 1870, dont subsistent
quelques jeux
fort beaux dans l'instrument actuel, comme je l'ai déjà
dit dans l'article sur
l'orgue de Saint-André. Profitons de cette occasion pour dire
que la qualité
des orgues construits par Goll et parvenus jusqu'à nous
rachète heureusement
l'aventure cathédralesque de ce malheureux facteur.
Cela nous entraîne peut-être un peu
loin des perspectives de
départ, mais permet de compléter ce petit tableau des
orgues de Grenoble à la
fin du XIX° siècle et au tout début du suivant. Il
faudra bien aussi un jour
reparler des travaux du facteur Anneessens puisqu'il y a toujours trois
orgues
initialement construits par lui à Grenoble et un aussi à
Vizille, celui de
Saint-André étant de loin le mieux conservé.
En conclusion, souhaitons que la
cathédrale, qui n'a plus
aujourd'hui à sa disposition qu'un orgue de huit jeux, comme
celui de
Cavaillé-Coll en 1869, mais avec la qualité en moins,
retrouve un jour un grand
orgue de tribune. Tribune reconstruite à la place et aux
dimensions de celle
stupidement détruite par Berruyer en 1862. Son buffet,
classé Monument
Historique et qui possède encore quelques tuyaux anciens,
pourrait y retrouver
avec bonheur les proportions qui furent les siennes jusqu'à
cette triste année.
Enfin, on pourrait y réédifier un grand instrument pour
lequel on aurait tout
intérêt à s'inspirer de la disposition si originale
de celui qui y trônait
alors. Espérons que l'association des Amis de l'orgue de la
cathédrale soit un
jour récompensée ainsi de ses efforts.
A la collégiale Saint-André,
après le grand relevage qui a
eu lieu en 2016-2017, que souhaiter de plus ? L'instrument sonne comme
il n'a
jamais sonné. Peut-être un jour verrons-nous la
restauration et la remise en
valeur du buffet XVIII°. Cela s'inscrirait logiquement dans le
cadre d'une
restauration intérieure du bâtiment. Mais quand on voit
déjà l'aspect
lamentable des extérieurs, on se doute que ce n'est pas pour
demain, même si le
classement de l'édifice aux Monuments Historiques peut laisser
une lueur d'espoir.
En plus des Inventaires des orgues déjà cités, je me suis référé bien sûr aux multiples publications concernant l'histoire de Grenoble et de ses églises, dont je n'ai pas l'intention de faire une bibliographie détaillée. Parmi les auteurs les plus autorisés sur ces sujets, on peut citer (de façon évidemment non exhaustive) Robert Bornecque, Alain de Montjoye et Renée Collardelle. Enfin, il faut citer l'intérêt particulier pour la partie centrale de cet article les deux livres de Gilles-Marie Moreau parus aux Editions de L'Harmattan :
On peut trouver bien sûr des indications intéressantes
dans
des ouvrages anciens, à condition cependant de les confronter
avec des
recherches plus récentes.